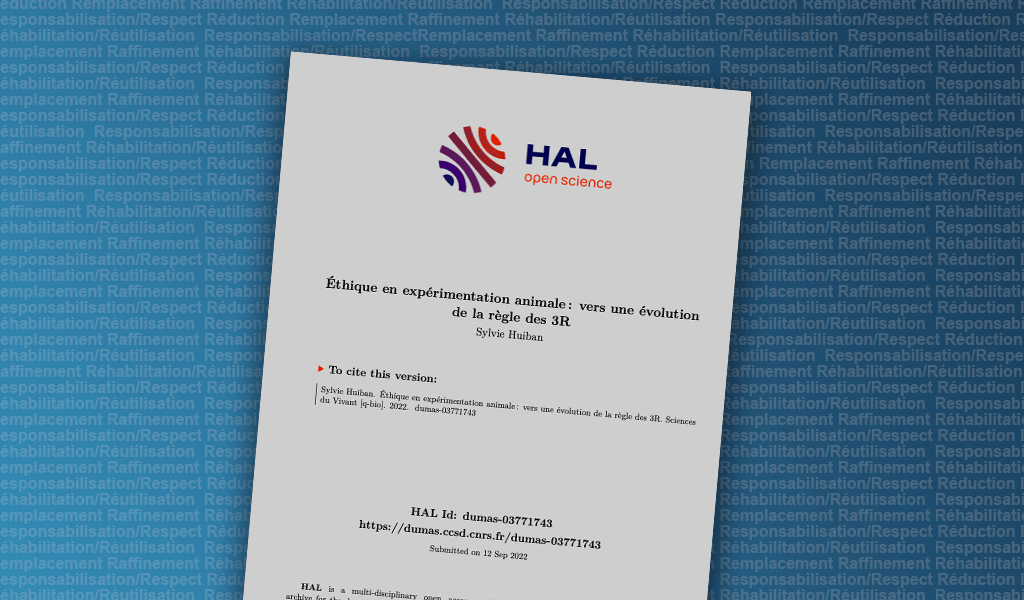Sylvie Huiban est vétérinaire d’exercice libéral. En 2022, elle a soutenu une thèse intitulée “Éthique en expérimentation animale : vers une évolution de la règle des 3R”. Nous l’avons interrogée.
Pourquoi avoir choisi ce sujet?
Sylvie Huiban : Si je suis devenue vétérinaire, c’est parce que les animaux ont toujours été une passion ! Il me tient à cœur de bien les traiter : cela passe par les soins, bien entendu, mais également par tout ce qui gravite autour de la cause animale, élevage, exploitation des animaux et bien entendu l’expérimentation animale. Un des membres de ma famille étant chercheur en neurobiologie, nous avons évidemment échangé ensemble de nombreuses fois et il m’est apparu intéressant de faire le point sur ce sujet car finalement tout le monde en parle et juge mais peu connaissent vraiment la réalité des choses.
Que connaissiez-vous sur les 3R avant de commencer votre thèse ?
SH : Avant de commencer ce travail, je n’avais qu’une vague idée de ce qu’était la règle des 3R ! Je savais que l’expérimentation animale était sérieusement encadrée mais je n’en connaissais pas les détails. Je ne me doutais pas de l’étendue des règles imposées aux chercheurs.
Qu’avez-vous appris pendant sa rédaction ? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ?
SH : Au cours de la rédaction de cette thèse, j’ai pu voir l’étendue des progrès faits en matière de méthodes alternatives et substitutives. Par exemple, l’utilisation des cellules souches dont on peut orienter la différenciation, les organoïdes et les organes sur puces (“organ-on-a-chip”) sont absolument fascinants ! Ils ouvrent la voie à de nouvelles recherches qui peuvent donner lieu à des progrès immenses en médecine ! Je pense en particulier au modèle “body-on-a-chip”, système plus représentatif du corps humain, qui permettrait de quasi s’affranchir du modèle animal et donc de diminuer considérablement le nombre d’animaux utilisés.
J’ai également beaucoup appris sur l’encadrement juridique de l’expérimentation animale, ainsi que sur les différentes instances qui interviennent à chaque étape d’un processus de recherche. Tout ceci constitue un maillage complexe et étendu à plusieurs domaines de compétence.
Comment percevez-vous le rôle du vétérinaire dans l’application des 3R ?
SH : Pour ma part, le rôle du vétérinaire dans l’application de la règle des 3R est d’accompagner et de conseiller tout au long du processus d’expérimentation. Sa connaissance des animaux en général et d’une ou plusieurs espèces en particulier, doit lui permettre de veiller à ce que leurs différents besoins soient respectés et satisfaits. Il se doit de pouvoir reconnaître les signes de souffrance de l’animal afin de les minimiser au maximum, précocement et efficacement. Cela sous-entend le bien-être animal en améliorant ses conditions de détention, aussi bien que lors des expérimentations en elles-mêmes par l’utilisation de médicaments adéquats. C’est pourquoi sa formation doit être continue et évolutive et ainsi lui permettre de faire appliquer les méthodes les plus récentes et adaptées aux besoins de sa structure.
Dans votre thèse, vous évoquez l’ajout de nouveaux R à la règle des 3R, pouvez-vous nous en parler ?
SH : En effet, il est beaucoup question à l’heure actuelle de faire évoluer cette règle des 3R en une règle des 5R, à savoir en plus Réhabilitation/Réutilisation et Responsabilisation/Respect.
La réhabilitation des animaux de laboratoire consiste à placer ceux-ci afin de leur offrir une seconde vie, soit en famille d’accueil, soit en centre spécialisé. Ce placement doit être envisagé dès le début du projet d’expérimentation de manière à faciliter leur futur changement de vie (sociabilisation, éducation…). Ce processus de réhabilitation prend de l’ampleur au fil des ans mais ne concerne encore que peu d’individus au total. Quant à la réutilisation, elle s’inscrit dans un cadre légal car tous les animaux ne peuvent pas être réutilisés. Néanmoins, les études montrent qu’elle progresse d’année en année.
En ce qui concerne la responsabilisation et le respect, cela passe par la formation des différents intervenants. Celle-ci est déjà en place puisque les personnels en fonction possèdent une formation initiale et sont soumis à une formation continue. Ce 5ème R est donc déjà en place ! Il n’impliquerait pas plus de contraintes que celles existantes.
En conclusion, la considération du bien-être de l’animal en expérimentation a beaucoup progressé ces 40 dernières années à l’instar de notre société. Il est dommage à mon sens de ne pas communiquer assez sur ces progrès afin de renvoyer au public une image plus juste de ce qui est mis en œuvre.
Source : DUMAS